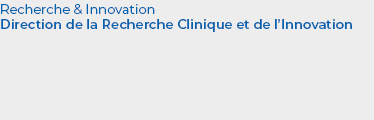Dans le cadre de l’élaboration des 30 leviers, de nombreux investigateurs ont relevé la complexité de l’organisation de la recherche à l’AP-HP. La description des circuits internes et l’articulation entre les différentes structures sont perçues comme étant insuffisamment lisibles.
Afin de rendre lisible notre organisation, l’AP-HP s’est engagée à l’automne 2023 à mettre à disposition une Foire Aux Questions (FAQ) destinée aux chercheurs.
La FAQ aborde déjà une cinquantaine de thématiques dont la gestion financière et ressources humaines des projets, la recherche sur données à partir de l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP, les dispositifs d’intéressement financier ainsi que les dispositifs de sanctuarisation recherche.
La FAQ est une plateforme vivante qui sera régulièrement enrichie et mise à jour. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez saisir le formulaire situé en bas de page et envoyer votre question.
La direction de la DRCI
Qu'est-ce que la CRI de l'AP-HP ?
La politique recherche et innovation de l’AP-HP est concertée avec la Commission Recherche et Innovation (CRI), les six commissions recherche de GHU et le Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP).
La Commission Recherche et Innovation de l’AP-HP (CRI), est co-présidée par le vice-président recherche du directoire (Pr Gabriel Steg) et par le président de la sous-commission recherche de la Commission Médicale d’Etablissement (Pr Eric Le Guern). Elle est concertée sur la définition des axes stratégiques de la politique de recherche et de l’innovation.
Elle est composé des vice-présidents recherche, des représentants de la CME et des présidents des commissions recherche et innovation locales.
Au 1er novembre 2023, sa composition nominative est :
- Pr Gabriel Steg, cardiologie, hôpital Bichat-Claude Bernard AP-HP,
- Pr Eric Le Guern, génétique, hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP,
- Pr Martin Chalumeau, pédiatrie, hôpital Necker – Enfants Malades AP-HP, président de la Commission d’Expertise Scientifique (CES)
- Pr Jérôme Berthérat, endocrinologie, hôpital Cochin AP-HP,
- Dr Boris Duchemann, cancérologie, hôpital Avicenne AP-HP,
- Pr Agnès Linglart, pédiatrie, hôpital Bicêtre AP-HP,
- Pr Laurent Mandelbrot, gynécologie-obtétrique, hôpital Louis-Mourier AP-HP,
- Dr Giovana Melica, immunologie, hôpital Henri-Mondor AP-HP,
- Loïc Morvan, directeur des soins de l’AP-HP,
- Pr Nicolas De Prost, médecine intensive-réanimation, hôpital Henri-Mondor AP-HP,
- Pr Alban Redheuil, cardiologie, hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP,
- Pr Tabassome Simon, pharmacologie, hôpital Saint-Antoine AP-HP,
- Pr Eric Vicaut, hôpitaux Saint-Louis Lariboisière AP-HP,
- Pr Marie Wislez, oncologie, hôpital Cochin AP-HP.
Qu'est ce que le CRBSP de l'AP-HP ?
La politique recherche et innovation de l’AP-HP est concertée avec la Commission Recherche et Innovation (CRI), les six commissions recherche de GHU et le Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP).
Le Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP), présidé par le vice-président recherche du directoire (Pr Gabriel Steg) veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent dans le cadre de l’article R6142-42 du Code de la santé publique.
Le CRBSP est une instance de concertation réunissant des membres nommés par l’AP-HP, par les Universités et par l’Inserm pour le compte des organismes de recherche et , ayant pour but de coordonner la recherche sur le site hospitalo-universitaire.
Le CRBSP a pour missions :
- de veiller à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent et de définir la politique concertée de développement de la recherche ;
- de veiller à la cohérence des stratégies et des moyens et ;
- d’assurer la liaison avec les organes extérieurs et partenaires impliqués dans la recherche.
Qu'est-ce que la CES de l'AP-HP ?
La Commission d’Expertise Scientifique (CES), présidée par le Pr Martin Chalumeau et vice-présidée la Pr Anne Bachelot est chargée d’expertiser et de classer les projets de recherche clinique qui lui sont soumis en réponse aux différents appels à projets internes de l’AP-HP et du GIRCI. La commission est pluridisciplinaire et réunit des expertises médicales, chirurgicales, pharmaceutiques, biologiques et paramédicales.
Quelles sont les missions de l'office d'intégrité scientifique de l'AP-HP ?
L’Office d’Intégrité Scientifique (OIS) de l’AP-HP en tant qu’établissement public contribuant au service public de la recherche est installée depuis avril 2022. Elle contribue à assurer la sensibilisation et la formation des professionnels au respect des exigences de l’intégrité scientifique ainsi que le traitement des signalements. L’office est présidé depuis juin 2022 par le Pr Marc Samama.
L’OIS est constituée autour de son président de :
- 6 référents universitaires intégrité scientifique ;
- 2 vices-présidents recherche du directoire de l’AP-HP ;
- 2 représentants de la CME désignés par son président ;
- La présidente du collège de déontologie de l’AP-HP ;
- 1 représentant de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique ;
- 1 représentant de l’intégrité scientifique de l’Inserm ;
- 1 personnalité qualifiée ;
- 1 représentant des usagers de l’AP-HP ;
- 1 journaliste ;
- 1 représentant de la direction des affaires juridiques de l’AP-HP ;
- 2 représentants de la direction de la recherche clinique et de l’innovation de l’AP-HP ;
L’office d’intégrité scientifique a pour missions :
- de sensibiliser les professionnels au respect des exigences de l’intégrité scientifique en matière de recherche et ;
- de proposer des mesures permettant la réalisation et l’organisation des travaux de recherche.
Bon à savoir :
La DRCI assure le secrétariat de l’office d’intégrité scientifique de l’AP-HP.
Votre contact :
integrite-scientifique@aphp.fr
Qu'est-ce que le guichet unique des promoteurs industriels et académiques de l'AP-HP ?
L’AP-HP est un partenaire privilégié des autres acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation en santé. La recherche partenariale est dans l’ADN de l’institution et se concrétise au moins à travers trois actions : un guichet unique pour les promoteurs académiques et industriels, une aide à la formalisation des relations contractuelles avec les partenaires industriels et/ou académiques dans le cadre des projets de R&D et l’Institut Carnot@AP-HP.
Le guichet unique des promoteurs industriels et académiques
Dans le cadre de la démarche d‘amélioration de son organisation, l’AP-HP dématérialise le dépôt des dossiers transmis par les promoteurs externes (académiques et industriels), en vue de l’élaboration de la convention hospitalière. Le dépôt du dossier se fait désormais via une plateforme de dépôt qui permet au promoteur d’obtenir un accusé de réception et un numéro de suivi.
Depuis juillet 2023, tous les nouveaux dossiers adressés au guichet des promoteurs industriels et académiques doivent obligatoirement être soumis sur la plateforme de dépôt via Timetonic.
Le processus de contractualisation s’effectue en cinq étapes :

Quelles sont les missions du Guichet Unique ?
- évaluer les surcoûts hospitaliers pour les projets à promotion externe (industrielle et académique) ;
- proposer une convention de surcoûts hospitaliers unique pour l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP ;
- disposer d’une vision exhaustive de l’activité de recherche à promotion externe.
Le Guichet Unique s’appuie sur les Correspondants de Recherche Clinique (CRC) des Directions de la Recherche des GHU de l’AP-HP qui ont pour rôle d’être les interlocuteurs de proximité entre le Guichet Unique et tous les professionnels de l’AP-HP participant aux recherches cliniques à promotion externe (investigateurs, responsables de plateaux médico-techniques, pharmaciens, …).
Les CRC sont également en charge de la facturation des sommes (surcoûts, RAF IFI, RAF ACA) résultant des études à promotion externe.
Comment formaliser les relations contractuelles avec un industriel dans le cadre de projets de R&D ?
L’AP-HP est un partenaire privilégié des autres acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation en santé. La recherche partenariale est dans l’ADN de l’institution et se concrétise au moins à travers trois actions : un guichet unique pour les promoteurs académiques et industriels, une aide à la formalisation des relations contractuelles avec les partenaires industriels et/ou académiques dans le cadre des projets de R&D et l’Institut Carnot@AP-HP.
Collaborations de recherche industrielles, académiques et institutionnelles
Dans le cadre des projets de R&D auxquels l’AP-HP contribue et participe, le secteur des collaborations de recherche a pour principale mission de formaliser les relations contractuelles des partenariats académiques publics-privés et mettant en œuvre des ressources, des moyens, leurs expertises, leurs compétences et le savoir-faire de l’AP-HP. En étroite collaboration avec les porteurs de projets, l’équipe s’attache particulièrement à définir les objectifs et les enjeux des partenariats au regard du périmètre scientifique défini par les porteurs et de la valeur des ressources et des moyens engagés par l’AP-HP.
Quelles sont les missions du secteur collaborations ?
- évaluer les enjeux en matière de propriété intellectuelle/valorisation des projets collaboratifs portés par les équipes et les professionnels de l’AP-HP ;
- négocier, rédiger et suivre les contrats de partenariat/collaboration de recherche (incluant les accords de transferts de matériels biologiques, données cliniques, base de données, etc.) ;
- contractualiser et suivre les projets de R&D portés par les équipes et professionnels de l’AP-HP quel que soit leur mode de financement ;
- en matière de recherche partenariale, conseiller et accompagner les équipes et les professionnels de l’AP-HP dans la mise en place de projets de recherche nationaux, européens ou internationaux, collaboratifs ou bilatéraux en adéquation avec les activités de promotion, de partenariat et de transfert de technologie, ainsi que de gestion financière.
Depuis novembre 2023, l’AP-HP a mis en place un outil de dépôt des demandes de contractualisation opéré par la plateforme Timetonic.
Un formulaire est mis à disposition des porteurs de projet, qui permet au secteur de recevoir les informations minimales pour instruire le dossier. L’outil évolue actuellement afin de permettre aux porteurs de suivre la progression des échanges entre le secteur et ses interlocuteurs internes et externes dans l’instruction des contrats de collaboration, et sera bientôt disponible (premier trimestre 2024).
Qu'est ce que le Carnot@AP-HP ?
L’AP-HP est un partenaire privilégié des autres acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation en santé. La recherche partenariale est dans l’ADN de l’institution et se concrétise au moins à travers trois actions : un guichet unique pour les promoteurs académiques et industriels, une aide à la formalisation des relations contractuelles avec les partenaires industriels et/ou académiques dans le cadre des projets de R&D et l’Institut Carnot@AP-HP.
Le Carnot@AP-HP
En 2020, l’AP-HP a obtenu le label Institut Carnot coordonné par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) devenant ainsi le premier CHU labellisé, une reconnaissance de l’excellence de la recherche partenariale réalisée à l’AP-HP. La DRCI coordonne l’Institut Carnot@AP-HP.
Au travers de la création de l’Institut Carnot@AP-HP, l’AP-HP ambitionne de structurer, dans le cadre du réseau des instituts Carnot, un pôle d’accélération de la recherche partenariale avec les entreprises engagées dans l’innovation sur l’ensemble du champ de la santé humaine : ses nombreuses expertises doivent lui permettre de co-construire avec ces entreprises, des solutions et des stratégies de développement répondant aux besoins de celles-ci.
L’AP-HP mène depuis de nombreuses années une politique partenariale ambitieuse : à l’origine très orientée vers les partenaires industriels du secteur pharmaceutique, cette stratégie s’est progressivement diversifiée pour répondre tant aux attentes des professionnels de l’AP-HP ainsi qu’à celles des acteurs socio-économiques désireux d’investir.
Vos contacts Carnot@AP-HP
- Gaèle Rigault, chargée du développement des partenariats industriels : gaele.rigault@aphp.fr, 01 40 27 57 53
- Daniele Grazziotin-Escargueil, coordinatrice Carnot@AP-HP : daniele.escargueil@aphp.fr, 01 40 27 56 03
- Stella Homer, chargée du développement de l’alliance « santé digitale et technologie numériques » : stella.homer@aphp.fr, 01 44 84 17 61

Quelles sont les plateformes supra-GHU de l'AP-HP ?
En complément des plateformes de recherche qui ont été développées depuis plusieurs années au sein des GHU, l’AP-HP a engagé un travail de structuration et de développement de plateformes de recherche supra-GHU.
Ces plateformes ont pour vocation de rassembler une expertise de référence et des équipements de pointe, dans une logique de mutualisation des moyens et d’excellence au niveau de l’AP-HP.
Elles peuvent être ouvertes au monde académique comme à des partenaires industriels et permettent aux chercheurs de bénéficier des technologies les plus performantes et de leur mise en œuvre rapide au sein des structures de recherche et d’innovation de l’AP-HP.
Parmi ces plateformes, peuvent notamment être citées :
Le Centre MEARY de Thérapie Cellulaire et Génique de l’AP-HP, qui a pour vocation la production et la distribution de médicaments de thérapie innovante (MTI) expérimentaux pour des maladies graves, chroniques ou rares, telles que les leucémies, l’insuffisance cardiaque, les brûlures oculaires.
L’Entrepôt de Données de Santé (EDS) de l’AP-HP, le plus gros entrepôt de données de santé hospitalier en Europe, qui contient aujourd’hui les données de plus de 14 millions de patients. Il appuie plus de 285 projets de recherche et d’innovation.
La Biobanque AP-HP pour la Recherche sur le Microbiote (BARM), est dédiée spécifiquement à la recherche sur le microbiote intestinal, avec un Hub centralisé à l’hôpital Saint Antoine assurant les étapes de réception, aliquotage, extraction d’ADN et stockage, avant séquençage de l’ADN pour la recherche sur le microbiote. Ce hub central collabore avec trois CRB de l’APHP (Bicêtre, Bichat et Cochin) participant en qualité de hubs décentralisés.
L’Unité Mixte de Service, Autonomia, créée à l’initiative de Sorbonne Université en partenariat avec l’AP-HP, est un centre de recherche en innovation technologique dont l’objectif est de favoriser les travaux de recherche et de développement pour lutter contre la dépendance liée à la maladie, au vieillissement ou aux situations de handicap. Cette plateforme est localisée au cœur de l’hôpital Charles-Foix à Ivry sur Seine, établissement de l’AP-HP.
L’Unité Mixte de Service CATI, la plateforme de service Centre d’acquisition et de traitement des images (CATI) créée en 2010 est devenue une UMS le 1er janvier 2022. Portée par l’AP-HP et Sorbonne Université, l’unité mixte de service CATI a pour objectif de faire émerger des protocoles standardisés d’acquisition et d’analyse d’images, pour obtenir un parc de données aux caractéristiques harmonisées sur les centres d’imagerie partenaires.
La plateforme d’impression 3D in house AP-HP, dite PRIM3D, qui vise à faire de l’impression 3D un instrument d’innovation au service d’une médecine personnalisée.
Le Centre d’Evaluation des Dispositif Médicaux (CEDM) est une plateforme pour l’aide aux industriels à la validation clinique de leurs DM, dans le contexte de la réglementation MDR 2017/745/UE. La plateforme est rattachée à l’URC Saint-Louis / Lariboisière/ Fernand Widal.
La plateforme R2P2 (Réanimation Pédiatrique Raymond Poincaré AP-HP), dont la fonction est le développement et la mise en œuvre de dispositifs médicaux et de thérapies dans le domaine du handicap neuromoteur et de la réanimation pédiatrique. Située à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches, elle est spécialisée dans le développement de solutions de pointe pour restaurer les fonctions motrices et la prise en charge du handicap neuromoteur en combinant médecine, physiologie, informatique et robotique.
La fondation Lumière est une plateforme de recherche translationnelle et d’enseignement ayant pour objet l’imagerie du fœtus, du placenta, et des anomalies congénitales. Animée par un comité de pilotage et un conseil scientifique multidisciplinaire, cette structure universitaire collaborative de la faculté de médecine de l’Université Paris Cité est implantée sur le site de l’hôpital Necker-Enfants Malades.
MOABI-APHP (Multi Omics Analysis & BIoInformatic) est une plateforme de l’AP-HP qui propose un ensemble de services et d’expertise aux pôles de biologie pour la gestion informatique du séquençage ADN très haut-débit : stockage et analyse des données dans le cadre du soin courant, conduite de projets scientifiques, infrastructures, logiciels ou ressources humaines en bioinformatique.
En quoi consiste le continuum de la recherche ?
La recherche est un ensemble d’actions qui a pour but d’améliorer et d’augmenter l’état des connaissances dans un domaine scientifique.
En recherche en santé, le continuum de la recherche va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée en santé.

 © DGOS – Bureau “Innovation et recherche clinique”
© DGOS – Bureau “Innovation et recherche clinique”
La recherche « clinique » ou « appliquée aux soins » :
- Pourquoi ? Pour le développement des connaissances biologiques et médicales, l’amélioration de la santé humaine, la génération et la validation scientifique d’activités médicales innovantes
- Assurée par qui ? Des équipes pluri professionnelles : médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire, infirmiers et autres personnels de santé et de recherche
- Pratiquée sur qui ? sur l’Homme (malade ou volontaire sain) ou sur des données de santé
- Comment ?
- Dans le respect de l’intégrité de chaque individu
- En évaluant la sécurité, la tolérance, la faisabilité ou l’efficacité des technologies de santé
Domaines concernés par la recherche clinique :
- les technologies de santé (médicaments, DM)
- l’amélioration des pratiques
- les organisations
- les sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé.
La recherche clinique industrielle :
- vise à tester de nouveaux médicaments (ou dispositifs médicaux) en vue d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) (marquage CE)
- analyse de marché
- plan de développement
La recherche clinique institutionnelle :
- vise à comparer des stratégies de soins existantes ou des techniques de diagnostic existantes, afin de les optimiser ou de les harmoniser
- tester des Hypothèses physiopathologique, Analyser des besoins de Santé (médicament, DM…)

Quels sont les différents types de recherche ?
Les Recherches impliquant la personne humaine (RIPH)

Pour vous accompagner à définir la typologie de votre recherche, l’URC est votre point de contact.
Réglementation des recherches interventionnelles

Références réglementaires
Textes principaux de référence en recherche médicale
Code de la santé publique :
- Première partie : Protection générale de la santé > Livre Ier: Protection des personnes en matière de santé > Titre II: Recherches impliquant la personne humaine (Loi Jardé)
- Partie législative : L1121-1 à L1126-12
- Partie réglementaire : R1121-1 à R1125-26
- Décrets/arrêtés complémentaires :
- Arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
- Bonnes Pratiques Cliniques (BCP)
- Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- RGPD 2018
- Règlement (UE) 536/2014 portant sur les essais cliniques des médicaments, adopté en mai 2014, entre en vigueur le 31 janvier 2022. Il remplace la directive 2001/20/CE.
Réglementation sur les RIPH
Code de la santé publique :
RIPH 2° : RIPHRCM (recherches impliquant la personne humaine à risques et contraintes minimes) :
RIPH 3° : RIPHRNI (recherches impliquant la personne humaine non interventionnelles)
Réglementation européenne
Règlement européen EC médicaments
Règlement européen Dispositifs Médicaux (DM)
Réglementation sur le traitement des données :
Loi informatique et liberté : https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee ou https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460
Règlement européen sur la protection des données : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees ou https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
Méthodologies de référence :
- MR001 (pour les RIPH avec consentement signé)
- MR002 (pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)
- MR003 (pour les RIPH de type 3 : non interventionnelles) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037187443
- MR004 (pour les hors lois Jardé : RNIPH) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037187498
- MR005 (pour la base nationale du PMSI) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037187535
Liens utiles
Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) :
- Texte des BPC : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2006/11/24/SANM0624752S/jo/texte
- Textes des ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) :
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines
(E6 : Good Clinical Practice
E8 : General considerations for clinical trials) - Formation : https://quiz-girci-idf.eliosys.net/login/index.php
Convention unique (promotion industrielle) : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/convention-unique
Comment monter un projet de recherche clinique ?

Les principales missions confiées aux URC sont :
- l’aide à la conception des programmes de recherche et d’assurer leur accompagnement (méthodologie, biostatistique, conformité, faisabilité, budgets prévisionnels, réponses aux appels d’offres) ;
- d’assurer le suivi et le contrôle de la qualité des recherches ;
- de gérer les données des projets ;
- de s’assurer du respect de l’intégrité scientifique jusqu’à la publication des résultats
- de participer, le cas échéant, à la coordination des activités de recherche du groupe hospitalier.
Les URC sont répartis au sein des 6 GHU de l’AP-HP. Pour accéder à l’organigramme des URC, cliquez ici
Quel est le rôle du promoteur AP-HP ?

Le rôle du promoteur est défini dans le code de la santé publique comme étant la « Personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche impliquant la personne humaine, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu ».
En particulier, le promoteur :
- Consolide le dossier technico-réglementaire
- Veille au respect des bonnes pratiques qui garantissent l’intégrité de l’étude : il est responsable de l’évaluation continue de la sécurité des patients afin de prendre si besoin toutes les mesures de sécurité nécessaires.
- S’assure que l’étude est autorisée (CPP, ANSM, CNIL…)
- Assure la gestion de la recherche et vérifie que le financement est acquis
Le promoteur et l’investigateur doivent s’assurer du respect des principes de bonnes pratiques clinique tout au long de la recherche.
Quel est le rôle de l'investigateur ?
Le rôle de l’investigateur : « La ou les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu »
Les essais sont dirigés par un investigateur coordonnateur (ou investigateur principal lorsque la recherche se déroule sur un seul lieu).
En particulier, l’investigateur :
- Informe les personnes sollicitées pour participer à l’étude ;
- Recueille l’accord de participation à l’étude ;
- Conduit l’essai dans son service (cabinet…) conformément aux « bonnes pratiques cliniques »
Le promoteur et l’investigateur doivent s’assurer du respect des principes de bonnes pratiques clinique tout au long de la recherche.
Quels sont les acteurs de la promotion et de l'investigation ?

Comment la recherche est-elle conçue ?

Eléments en cours de rédaction
Comment est-elle réalisée ?

Eléments en cours de rédaction
Comment est-elle suivie ?

Eléments en cours de rédaction
Comment se termine un projet de recherche clinique ?
Fin de la recherche – Traitement des données et publication

Eléments en cours de rédaction
Quelles sont les phases d'un essai clinique ?
Phase 1 : première administration chez l’Homme
La phase 1 correspond à la première administration de la molécule chez l’homme. Elle est réalisée sur des personnes non atteintes par la maladie (sujets sains). Elle a pour but d’étudier :
- La tolérance clinique et biologique : permet de définir la dose maximum tolérée par l’organisme
- La pharmacodynamique : permet de définir les effets sur l’organisme et de déterminer la dose minimale ayant une activité thérapeutique
- La pharmacocinétique : permet de définir le devenir de la molécule dans le corps en fonction du mode d’administration (oral, intraveineux, etc.)
Phase 2 : première administration chez les malades
La phase 2 correspond à la première administration de la molécule chez des malades. Deux étapes composent cette seconde phase (phase 2a et phase 2b).
Cette phase ne concerne qu’un nombre limité de personnes et sur une période courte de traitement.
Phase 3 : l’efficacité thérapeutique
La phase 3 appelée aussi “étude pivot” correspond à la dernière phase avant la commercialisation de la molécule en tant que médicament. Elle permet de mesurer l’efficacité thérapeutique de la molécule et sa tolérance dans les conditions proche de la vie réelle.
Cette étape concerne un grand nombre de malades sur une période longue de traitement. Les conditions d’administrations sont proches des conditions d’utilisation du futur médicament?.
Phase 4 : l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
L’ensemble des données collectées au cours des différentes phases (de la phase 1 à la phase 3) du développement d’une molécule permet le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’agence nationale de Sécurité du Médicament et produits de Santé (ANSM). Lorsque l’autorisation est obtenue, la molécule est reconnue médicament et est commercialisée.
Quelles sont les structures AP-HP de soutien à la recherche ?

La DRCI et les 12 URC et URC-éco de l’AP-HP travaillent en étroite collaboration avec l’ensemble des structures de soutien à la recherche clinique rattachées aux groupes hospitaliers de l’AP-HP :
- 17 Centres d’Investigation Clinique (CIC) dont :
- 8 modules Plurithématiques (CIC-P)
- 5 modules Biothérapie (CIC-BT)
- 3 modules Epidémiologie clinique (CIC-EC)
- 1 module Innovation technologique (CIC-IT)
- 3 Centres de Recherche Clinique (CRC)
- 12 Centres de Ressources Biologiques (CRB)
- 5 Plateformes de Ressources Biologiques (PRB)
En cas de besoin, contactez l’URC de votre choix ou le pôle promotion de la DRCI à l’adresse : drc-secretariat-promotion@aphp.fr
Comment participer à un projet de recherche promu par un partenaire ?
Le guichet unique des promoteurs externes de l’AP-HP assure la contractualisation nécessaire à la réalisation d’une recherche promue par un tiers et mise en place à l’AP-HP. Il s’appuie sur les directions de la recherche des GHU de l’AP-HP qui assurent la proximité avec les professionnels de l’AP-HP participant aux recherches cliniques à promotion externe (investigateurs, responsables de plateaux médico-techniques, pharmaciens, Centres d’Investigation Clinique (CIC) …)
En France, la loi impose la prise en charge par le promoteur des coûts générés par la recherche.
Pour les promoteurs industriels, le format de la convention et de la grille est imposé par la réglementation. Pour les promoteurs académiques, les CHU se sont accordés sur une convention unique académique associée à une grille financière (également utilisée avec de nombreux centres hospitaliers). Si plusieurs services de l’AP-HP sont impliqués dans la réalisation d’une étude, une seule convention est établie pour la participation de tous les services de l’AP-HP.
Cette convention est négociée et signée par la DRCI.
Si l’étude nécessite aussi d’établir un contrat de prêt de matériel, celui-ci est géré directement par les Directions de la recherche des GHU (Remettre ici la liste des CRC) : lien vers la liste dispo sur internet page du guichet
Depuis le 3 juillet 2023, le processus de contractualisation des recherches partenariales fait l’objet d’une dématérialisation. En vue de l’élaboration de la convention hospitalière et de la validation des grilles de surcoût, le dépôt des nouveaux dossiers et des avenants aux dossiers en cours se fait dorénavant sur une plateforme de dépôt qui permet au promoteur d’obtenir un A/R et un numéro de suivi. Cela vous permettra ainsi qu’au promoteur de suivre les étapes d’instruction des demandes.
Des tutoriels explicatifs sont à votre disposition sur la page du guichet des promoteurs industriels, académiques et institutionnels
Quelles sont les informations disponibles dans le registre des essais cliniques de l'AP-HP ?
Le registre des essais cliniques est un moteur de recherche disponible à tous sur le site internet de l’AP-HP. Il permet aux professionnels de santé, aux patients ainsi qu’aux usagers d’accéder à des informations sur les essais en cours à l’AP-HP.
Le moteur de recherche dédié au registre des essais cliniques de l’AP-HP a pour objectif de fournir aux patients et aux professionnels de santé des informations fiables et actualisées mensuellement, sur tous les essais cliniques se déroulant à l’AP-HP.
Il contient des protocoles d’essais cliniques sous forme de résumés destinés aux patients, des informations scientifiques plus détaillées pour les professionnels, la liste des centres français participant à l’essai clinique et un formulaire de contact qui permet aux utilisateurs du registre de poser leurs questions aux investigateurs coordonnateurs et se porter volontaire.
En novembre 2023, plus de 1 585 essais cliniques dont 834 a promotion AP-HP sont publiés sur le site internet de l’AP-HP.
Pour aider les utilisateurs à mieux cibler leur recherche, ce registre dispose :
- d’une recherche ciblée par mots clés (Il est possible de saisir une pathologie, un organe, le nom d’un essai clinique ou le nom d’un investigateur coordonnateur). La loupe donne accès aux résultats ;
- d’un moteur de recherche multicritères permettant de sélectionner les essais cliniques en fonction de différents filtres comme la spécialité médicale, la localisation géographique des centres participants, la liste des établissements/services impliqués dans des essais cliniques, les populations pouvant participer à la recherche, la phase de l’essai.
Votre contact pour plus d’informations ou pour faire des suggestions : communication.drc@aphp.fr
Bon à savoir : retrouvez l’ensemble des informations relatives au registre des essais cliniques sur le site web de l’AP-HP.
Quelles sont les informations disponibles dans la veille des appels à candidatures de l'AP-HP ?
L’ensemble des équipes de la DRCI (pôles et URC) se tiennent à votre disposition pour vous guider dans la mise en œuvre et le suivi de votre recherche, la recherche de financement et la valorisation de vos travaux.
La direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI) informe le personnel de l’AP-HP sur les appels lancés par les acteurs publics et privés de la recherche tout au long de l’année.
Via l’intranet, dans le volet « Porteurs de projets et professionnels de recherche » du chapitre « Recherche et innovation » plusieurs veilles sur les appels à projets sont disponibles.
- La veille des appels à projets gouvernementaux via la page du plan France 2030 ;
- Le moteur de recherche (thésaurus des appels à projets) ;
- Le portail appelsprojetsrecherche.fr
La DRCI informe aussi les professionnels de l’AP-HP sur les opportunité internes de financement ou de sanctuarisation du temps dont ils peuvent bénéficier.
En effet, l’AP-HP encourage ses professionnels à mener les projets de recherche à l’aide d’appels internes comme le « booster innovation », ou l’appel à candidatures « Temps médical protégé recherche clinique » lancé dans le cadre des « 30 leviers pour agir ensemble » en mars 2023.
Depuis septembre 2023, une veille mensuelle des appels à candidatures en cours est adressée à l’ensemble des personnels médicaux de l’AP-HP. Cette veille est également disponible dans l’onglet « Appels à projets » du site web de la recherche clinique et de l‘innovation de l’AP-HP.
Votre contact à la DRCI : secteur communication, communication.drc@aphp.fr
Je suis sollicité pour participer à un projet européen, qui dois-je contacter au préalable ?
Le Secteur Europe est l’équipe dédiée aux projets financés par la Commission Européenne. Elle accompagne les personnes souhaitant monter et participer aux projets européens.
Le secteur Europe est le point d’entrée unique de l’AP-HP pour la gestion des projets de recherche financés par la Commission européenne. Il accompagne les projets européens depuis leur démarrage jusqu’à leur clôture en proposant un accompagnement complet.
Pour contacter le Secteur Europe, écrire à l’adresse mail suivante : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Une fois l’équipe contactée, un(e) chargé(e) de mission reviendra vers vous pour vous aiguiller dans les démarches selon votre projet.
Point d’attention : il est recommandé de contacter le Secteur Europe le plus tôt possible avant la date limite de dépôt pour permettre la bonne instruction du projet par toutes les parties prenantes. À défaut, la faisabilité devra être instruite par la DRCI en cas d’évaluation favorable.
On me demande un numéro « PIC », où puis-je trouver ce numéro ?
Pour pouvoir déposer un projet européen, il vous sera demandé un identifiant appelé PIC (Participant Identification Code). L’AP-HP dispose déjà d’un numéro, unique pour l’ensemble de ses hôpitaux, il n’est nécessaire d’en créer un nouveau.
Pour obtenir le numéro « PIC » de l’AP-HP, vous pouvez contacter le Secteur Europe, à l’adresse mail suivante : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Quels sont les principaux critères d’éligibilité pour répondre à un appel à projets Horizon Europe ?
Les projets attendus sont dans la majorité des cas des projets collaboratifs. Et, dans le cadre de projets collaboratifs, le consortium doit être composé d’au moins trois entités juridiques indépendantes, chacune étant établie dans un État membre ou dans un autre pays associé à Horizon Europe (et avec au moins une des entités établies dans un État membre).
Des exceptions existent : par exemple, les projets ERC peuvent être déposés par une seule entité.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Secteur Europe : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Puis-je collaborer avec des partenaires hors-Europe ?
Oui, la plupart des appels à projets Horizon Europe sont ouverts aux participants des pays tiers et aux collaborations internationales, mais leur financement n’est pas automatique :
- Un certain nombre de pays tiers contribuent au budget d’Horizon Europe et ont signé un accord d’association avec la Commission européenne. Les entités basées dans ces pays peuvent donc percevoir un financement au même titre que les entités basées dans l’un des pays de l’UE. La liste (évolutive) des pays tiers associés est disponible ici. Point d’attention : L’accord d’association du Royaume-Uni à Horizon Europe entre en vigueur le 1er janvier 2024.
- Certains pays à faibles et moyens revenus hors Europe sont automatiquement éligibles au financement.
- Cas particulier des USA : les entités établies aux Etats-Unis sont éligibles au financement automatique par la Commission européenne uniquement dans le Cluster Santé
- Pour certains pays comme le Canada, l’Australie, le Brésil ou le Mexique, des mécanismes de co-financement sont mis en place par les agences nationales concernées selon des modalités qui leurs sont propres. Point d’attention : La Suisse est toujours considérée comme un pays tiers non associé en ce qui concerne Horizon Europe ainsi que les programmes et initiatives qui y sont liés. Les entités basées en Suisse peuvent toujours participer à la plupart des projets collaboratifs : le financement est assuré par le SEFRI pour tous les projets ayant reçu une évaluation positive.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Secteur Europe : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Je souhaite répondre à nouveau à un appel à projet européen après un premier refus. Puis-je le faire ?
Il est possible de répondre à nouveau à des Appels à Projets européens malgré les refus.
Toutefois, une restriction à la re-soumission d’un ou deux ans peut s’appliquer dans certains cas (pour les projets ERC par exemple).
Dans tous les cas, il est recommandé de reprendre contact avec le Secteur Europe avant chaque dépôt (affaires-europeennes.drc@aphp.fr) pour adapter votre projet aux exigences du nouvel appel, et actualiser le budget si nécessaire.
Comment rechercher un financement européen ?
Vous cherchez un financement pour votre projet de recherche ? Le Secteur Europe vous accompagne pour trouver l’Appel à Projet européen le plus adapté !
Vous pouvez consulter les Appels à Projets sur le lien du portail Funding & Tenders.
Cela vous permet d’accéder à une recherche multicritère (calls à venir, ceux ouverts actuellement, ceux clôturés, programme, période programmation…). Ainsi, vous pourrez naviguer dans les différentes possibilités de financement.
Pour vous accompagner sur cette plateforme, vous pouvez contacter le Secteur Europe à l’adresse mail affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Quels sont les différents types de financement ?
Il y a plusieurs programmes de financement de la Commission Européenne regroupant plusieurs types d’appels à projet que voici :
- Horizon Europe
- Projets collaboratifs en santé
- Mission Cancer
- ERC (bourses d’excellence nominative au nom d’un médecin)
- EIC (Conseil Européen de l’innovation)
- IHI : Ce sont des projets en partenariat public/privé avec des industriels.
- Digital Europe
Ces projets sont principalement sur les avancées digitales et moins axées sur la santé, mais la constitution par exemple d’un entrepôt de données de santé géant sur une pathologie peut rentrer dans ce type d’appel à projet.
- EU4Health
- Les ERN (réseaux de santé maladies rares européennes)
- Des projets de santé publique avec des financements partiels
- Les appels à projets « Transnationaux » contractualisés avec l’ANR et la DGOS
- THCS : Transformer les systèmes de santé et de soins (ANR et DGOS)
- EJP RD : Programme commun européen sur les maladies rares (ANR)
- EP Permed : Partenariat européen pour la médecine personnalisée (ANR)
- NEURON : Réseau de financement européen pour la recherche en neurosciences (ANR)
- JNPD research : Recherche sur les maladies neurodégénératives (ANR)
- JPIAMR : Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (ANR)
Pour vous aider à identifier l’appel à projet qui conviendrait le mieux, et vous accompagner dans le montage de votre projet, vous pouvez contacter le Secteur Europe à l’adresse mail affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Je souhaite monter un projet européen en coordination mais je manque de temps. Quelles solutions sont proposées ?
Un dispositif permet de libérer du temps pour le montage d’une coordination européenne avec une enveloppe dédiée. En effet, plusieurs solutions peuvent être mobilisées (cumulatives sous conditions) :
Il est possible également de mobiliser les dispositifs MRSEI (36 K€ pour une durée de 24 mois) & SRSEI de l’ANR (17 K€ pour une durée de 12 mois) destinés à :
- Frais de missions liés à la constitution du réseau
- Organisation de réunions
- Participation au financement de la prestation d’accompagnement par un cabinet, le cas échéant (dans la limite de 10K €)
Des cabinets de conseil peuvent être mobilisés pour un montage de projet en coordination : 4 cabinets de conseil font partie du marché-cadre de l’AP-HP. Pour les contacter, il s’agira d’écrire au Secteur Europe à l’adresse mail affaires-europeennes.drc@aphp.fr
En interne, un accompagnement appuyé sera réalisé par des Chargés de mission du Secteur Europe, en binôme avec les chargés de mission « Montage » au sein de l’équipe des Grands Projets Nationaux.
Comment élaborer un budget pour le projet européen que je souhaite mener ?
Contacter l’URC et le Secteur Europe est indispensable en vue de monter un budget équilibré et qui correspond aux actes et activités prévus dans le projet. Les deux équipes ont des expertises complémentaires : l’expertise clinique pour l’URC et les règles européennes / éligibilité des coûts pour le Secteur Europe.
Le risque de monter un budget sans URC serait de sous-estimer le coût de la participation à une étude clinique. Ainsi, ne pas avoir suffisamment de fonds pour aller jusqu’au bout du projet pourrait contraindre l’investigateur principal à y renoncer.
Quand et comment est versé le financement de la Commission Européenne ?
Les fonds de la Commission Européenne sont échelonnés dans le temps :
- Un préfinancement est versé au début du projet suite à la contractualisation (Grant Agreement et Consortium Agreement validés et signés)
- Des paiements intermédiaires suite à la soumission de rapports techniques et financiers
- Le versement final à la clôture du projet
Quelle est la durée de disponibilité de financement ?
Pour les projets financés par la Commission Européenne, le financement est borné par le début et la fin du projet. L’éventuel reliquat est utilisable 2 ans après la notification du service Gestion attestant la validation des rapports finaux.
Comment utiliser le budget alloué et suivre son exécution ?
Le Secteur Europe de la DRCI est le point de contact pour le suivi budgétaire. Il fait le lien avec l’URC et le pôle Gestion pour :
- Valider et suivre les dépenses du projet en fonction du budget
- Préparer les éléments pour la demande des recettes
- En cas d’imprévu, de dépenses supplémentaires, modifier le budget en lien avec l’investigateur(trice) principal(e) en ajustant les différents postes du budget
- Transmettre le suivi budgétaire à la fréquence définie avec l’investigateur(trice) principal(e) ou à la demande
Comment procéder à des achats de matériel (ordinateurs, machine médicale…) ?
Les achats de matériels doivent répondre à la fois au processus interne et aux règles européennes. Une dépense d’achat doit avoir été prévue dès le montage du projet.
C’est pourquoi, aux vues de la complexité, il est important de suivre les procédures :
- Informer le Secteur Europe et l’URC dès le montage du projet de l’achat envisagé (qui tiendra compte des règles européennes)
- Pour procéder à la dépense au cours du projet, se rapprocher du secteur Europe et de la cellule Recherche de votre GH
- Le Secteur Europe informe des règles pour les projets financés par la Commission Européenne. Pour se faire rembourser de l’achat, plusieurs facteurs entrent en considération :
-
- Date de début et de fin d’utilisation de l’équipement
- Durée d’amortissement de l’équipement
- Quotité d’utilisation de l’équipement
- Si le devis de cet achat est supérieur à 40 000 € HT, il s’agira de faire un Appel d’Offre. La cellule achat/marché de votre GHU pourra orienter l’investigateur(trice) principal(e).
A défaut de suivre ce process, l’achat d’équipement ne pourra être réalisé.
En tant qu’investigateur principal, puis-je signer un contrat au nom de l’AP-HP ?
Seul le Directeur de la DRCI est habilité à engager contractuellement l’AP-HP. Cela s’applique pour tout type de contrat (contrats d’achat, demande de subvention, Data Sharing Agreement…).
Je dois voyager dans le cadre du projet. Comment faire ?
Plusieurs volets sont à vérifier simultanément avant de voyager dans le cadre du projet :
- Vérifier le budget alloué aux frais de déplacement / voyage avec le Chargé de mission Secteur Europe, qui vous communiquera les codes fonds à utiliser
- Penser à établir un ordre de mission (qui permet de vous faire rembourser vos frais de mission et permet une couverture par la police d’assurance de l’AP-HP)
- Se rapprocher de la Cellule Recherche / Economat de votre GH, qui peut se charger des réservations d’hôtel et des billets. Il est recommandé de privilégier la réservation par l’agence de voyage de l’AP-HP (Vairon Voyages), pour éviter les avances de frais.
- Les frais de repas et de transport sur place (métro, bus, taxis…) sont remboursés via justificatifs. Pensez à exiger un reçu pour toute dépense.
Si la mission se déroule à l’étranger, le per diem est calculé sur la base des taux fixés pour chaque pays par le ministère des Finances : www.economie.gouv/dgfip/mission
Il s’agit d’un forfait qui doit couvrir tous les frais usuels et courants, y compris les petits trajets en taxi, les repas (si non pris en charge par l’organisateur) et l’hôtel. Dès le retour de mission, les justificatifs originaux seront à transmettre à la cellule Recherche de votre GH. Pensez à en conserver une copie.
En plus des justificatifs de dépenses, penser à transmettre au Secteur Europe l’ordre du jour de la réunion, l’invitation ou la liste d’émargement
Comment se déroule le suivi du projet européen ?
Une équipe dédiée au suivi du projet vous accompagne à chaque instant de vie du projet : de l’idée de projet jusqu’au rapport final (et au-delà si nécessaire !).
Cette équipe est présente à vos côtés tout au long du projet de recherche. En effet, elle a pour but de sécuriser le parcours des équipes médicales dans tous les volets administratifs, juridiques et financiers.
Vous pouvez contacter le Secteur Europe à l’adresse mail : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
J’ai un problème ou une interrogation concernant le projet européen auquel je participe. Qui dois-je contacter ?
Quelle que soit la nature du problème rencontré, vous pouvez vous adresser au Secteur Europe. Celui-ci vous apportera les solutions ou vous mettra en relation avec les ressources clés pour les obtenir.
Pour joindre le Secteur Europe, écrire un mail au point de contact Secteur Europe. A défaut, vous pouvez utiliser l’adresse mail affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Vos contacts :
- Responsable de secteur : Amélie Guisseau – amelie.guisseau@aphp.fr
- AP-HP. Centre :
- Nicolas Bertolucci – nicolas.bertolucci@aphp.fr
- Kevin Bonny – kevin.bonny@aphp.fr
- AP-HP. Nord
- Aurélien Calvetti – aurélien.calvetti@aphp.fr
- Nicha Le Dall – nicha.ledall@aphp.fr
- AP-HP. Seine-Saint-Denis – Siège de l’AP-HP
- Aurélien Calvetti – aurelien.calvetti@aphp.fr
- AP-HP. Sorbonne
- Madliane Bolly – madliane.bolly@aphp.fr
- Essuih Koffi – essuih.koffi@aphp.fr
- AP-HP. Saclay – AP-HP. Mondor
- Essuih Koffi – essuih.koffi@aphp.fr
Comment être accompagné sur le montage de mon projet européen ?
L’AP-HP a lancé un nouveau dispositif destiné à soutenir les porteurs de projets européens en coordination : « Temps dédié montage de projets ». Il s’agit d’un dispositif agile, personnalisé et adapté au calendrier des appels à projets pour permettre aux porteurs de projets de libérer du temps pour leur candidature aux appels à projets européens d’envergure (Horizon Europe, IHI, Mission Cancer, etc.).
Le dispositif vise à :
- financer les services concernés, à hauteur de 30 000 €, en contrepartie du temps passé par les porteurs de projets pour préparer leur candidature. L’utilisation de l’aide par le service est libre (sous réserve d’effectivement libérer du temps au porteur du projet) ;
- aider directement le porteur de projet dans le montage du dossier, à hauteur de 10 000 €, en finançant la traduction, la relecture du projet, ou l’organisation de réunions, selon les besoins.
Votre contact à la DRCI : le secteur Europe, affaires-européennes.drc@aphp.fr

Comment rechercher un consortium européen ?
Afin de rechercher des consortiums et des partenaires dans le cadre de projet européen, 2 options sont possibles :
- Option 1 : Rechercher sur le portail européen Funding & Tenders les opportunités existantes
Il s’agira de cliquer sur ce lien vous renvoyant sur le portail européen Funding & Tenders qui vous mènera sur le portail ci-dessous :

Pour une recherche avancée sur cette interface, il s’agira de :
- Renseigner éventuellement le champ « keyword » par des mots-clés
- Décocher « Persons » et conserver « Organisations » coché
- Choisir un « Programme », « Topic », « Location » etc. en fonction de votre souhait de sélectivité
- Cocher la case « Profiles with published Partner search announcements »
- Cliquer sur « Search »
Option 2 : Publier une offre d’expertise sur le portail Funding & Tenders
Cela a pour but d’être contacté en vue de constituer un consortium pour construire un projet européen. Pour élaborer cette offre, il s’agira de contacter le Secteur Europe à l’adresse mail : affaires-europeennes.drc@aphp.fr
Qu’est-ce que la recherche sur données de santé à l’AP-HP ?
La recherche s’appuyant sur la réutilisation des données de santé est en plein essor dans les établissements de santé.
L’utilisation secondaire ou réutilisation des données de santé correspond au traitement ultérieur de données de santé collectées initialement à d’autres fins (exemple des données collectées initialement pour le suivi médical et réutilisées à des fins de recherches)
Les données de santé concernées par la recherche sur données à l’AP-HP peuvent être les données de santé issues du soin et recueillies dans les DPI ou les données de santé issues de recherches recueillies dans les cahiers d’observation électroniques (eCRF).
Ces données peuvent être rassemblées au sein de l’EDS AP-HP (données issues du soin), au sein de registres/cohortes (données issues de recherches) ou encore d’autres bases de données spécialisées sur une pathologie ou une population de patients spécifique.
Ces données sont parfois chaînées aux données du Système National des Données de Santé (SNDS).
Les recherches s’appuyant sur les seules données du SNDS font aussi l’objet d’une demande croissante de la part des professionnels de santé de l’AP-HP.
Réglementation et grands principes à respecter
- La réutilisation de ces données est soumise à des démarches réglementaires qui peuvent varier en fonction du cadre dans lequel ont été initialement recueillies ces données et en fonction du périmètre de la recherche (monocentrique ou multicentrique)
- En particulier le RGPD et la Loi Informatique et Libertés (MR-001 à MR-006, référentiel EDS, référentiel SNDS etc.) posent des principes à respecter.

Les méthodologie de référence de la CNIL (ou MR)
Lorsque le responsable de traitement réalise une recherche en conformité avec une méthodologie de référence, la demande d’autorisation auprès de la CNIL n’est pas nécessaire.

Les obligations en cas de collecte / traitement de DP :

Comment effectuer une recherche utilisant les données de l’Entrepôt de Données de Santé de l’AP-HP ?
L’AP-HP a obtenu l’autorisation de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) en janvier 2017 pour « mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé ». L’Entrepôt de Données de Santé (EDS) de l’AP-HP rassemble aujourd’hui les données de santé de plus de 19 millions de patients traités dans les 38 hôpitaux de l’AP-HP : données démographiques, données du PMSI (diagnostics CIM-10, actes CCAM), résultats de biologie, prescriptions médicamenteuses et comptes rendus médicaux. Les examens d’imagerie, stockés sur le PACS, peuvent être copiés dans l’EDS pour les besoins d’une recherche.
Données de l’EDS :
L’EDS est en constante évolution avec l’intégration au fil du temps de nouvelles catégories de données. Vous trouverez l’ensemble des informations relatives aux données et outils disponibles ainsi qu’au calendrier d’intégration prévu sur le site internet de l’EDS :
- Lien direct vers les règles d’accès aux données de santé de l’AP-HP
- Lien vers les outils disponibles
- Lien direct vers la cartographie des données disponibles
- Lien vers la disponibilité des données dans l’EDS AP-HP (Cliquez sur le bouton rose “Disponibilité données”)
En pratique :
Pour tout projet de recherche utilisant les données de l’EDS, la première étape consiste à se rapprocher des référents EDS des Unités de Recherche Clinique (URC) et/ ou des Groupes hospitalo-universitaires (GHU), et de remplir un formulaire de demande de dépôt de projet :
En pratique votre projet fera l’objet d’une évaluation de sa faisabilité technique avec les équipes de la DSN et organisationnelle avec la DRCI à partir des éléments renseignés. Cela permet de vous accompagner dans l’identification du budget nécessaire à sa bonne réalisation et au respect du calendrier avant un dépôt pour validation au Comité Scientifique et Ethique de l’EDS.
Après validation par le CSE et sous réserve de la signature des contrats avec les partenaires (le cas échéant), les données nécessaires à la réalisation de votre projet seront mises à disposition dans un espace de travail dédié avec les services numériques demandes.
L’ensemble du suivi de ces étapes d’instruction sera disponible pour vous et vos partenaires via le processus dématérialisé sur Timetonic.
Votre contact à la DRCI : Dr Claire HASSEN-KHODJA
En synthèse :
Le processus d’instruction des projets utilisant les données de l’EDS va être en partie « automatisé » pour faciliter et fluidifier le dépôt, rendre visibles les différentes étapes d’instruction et le suivi des projets de recherche à l’instar des guichets uniques académiques et industriels.

Comment effectuer une recherche à partir du SNDS ?
Le SNDS rassemble les données de remboursement des régimes d’assurance maladie obligatoires (SNIIRAM), les données des établissements de santé publics et privés (PMSI) et les données sur les causes médicales de décès (CépiDc). La CNAM et le Health Data Hub (HDH) sont les responsables conjoints du SNDS.
Formations au SNDS
- Au vu de la complexité des bases de données constituant le SNDS, et des risques de réidentification des personnes, il est obligatoire de se former pour accéder aux données du SNDS. Ces formations sont payantes.
- Si vous êtes personnel d’une URC, il faut contacter le service formation de la DRCI en indiquant précisément les formations et dates de formations souhaitées drc@aphp.fr
- Toutes les informations relatives aux formations sont disponibles sur le site de l’institut 4.10.
- Le catalogue des formations
- Si vous êtes personnel médical, il faudra contacter le Centre de Formation et du Développement des Compétences de l’AP-HP (CFDC) qui va récupérer la gestion de l’actuel DPCM.
L’AP-HP dispose d’un accès permanent au SNDS à des fins de recherche.
La DRCI est autorité d’enregistrement déléguée (AED) et habilite les utilisateurs formés avec l’attribution de profils en fonction des données nécessaires aux projets de recherche : données de l’ESND (nouvel échantillon des données du SNDS) ou données exhaustives du SNDS.
Une fois formé, Il faut contacter l’AED avec les documents suivants :
- Attestations de formations au SNDS
- Document-type « L’UTILISATEUR DU COMPTE SNDS » pour la demande de calculette à la CNAM
- La calculette permet de générer des mots de passe à usage unique pour accéder au SNDS
- DOCUMENT-TYPE DÉCRIVANT LES CARACTÉRISTIQUES DES TRAITEMENTS PORTANT SUR DES DONNÉES INDIVIDUELLES DU SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE SANTÉ
- Ce document est intégré au registre des activités de traitement de l’AP-HP et pourra être mis à disposition de la CNIL en cas de contrôle
- Les traitements doivent également être inscrits sur le registre unique du Health Data Hub (procédure en attente de formalisation)
Respect des CGU lors de la connexion au portail SNDS
Travailler sur les postes AP-HP uniquement (et non des postes personnels)

Accès sur projets
- Pour tout projet de recherche visant à utiliser des données de santé de l’AP-HP chaînées aux données du SNDS, la première étape consiste à se rapprocher d’une URC pour évaluer la faisabilité du projet et les ressources nécessaires puis il faudra compléter les documents du starter kit proposé par le HDH
- L’accès au SNDS est conditionné à l’avis favorable du CESREES et à l’autorisation de la CNIL
Les recherches avec chaînage sont soumises à l’avis du CESREES et à l’autorisation de la CNIL

Accès ponctuels au SNDS sur projets :
- Le Responsable de Traitement (RT) dépose une demande d’autorisation auprès du Health Data Hub, qui valide la complétude du dossier, et peut s’auto-saisir pour examiner l’intérêt public du traitement. Le Health Data Hub doit adresser sous 7 jours ouvrés le dossier dans sa complétude au CESREES.
- Le Comité Éthique et Scientifique pour les Recherches, les Études et les Évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) émet un avis sur la méthodologie scientifique du projet, et le recours à des données à caractère personnel (délai : 1 mois)
- La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) prend connaissance des avis du CESREES, et donne une autorisation pour le projet (délai : 2 mois, renouvelable une fois)
- A l’issue de l’autorisation CNIL et après signature d’une convention, les données SNDS nécessaires à l’étude pourront être traitées dans un espace projet dédié (délai indicatif de mise à disposition des données : 2 mois)
- La CNAM délivre les habilitations
Appariements déterministes sur le NIR et tiers de centralisation.
Réglementation et grands principes à respecter :
- Respect des conditions générales d’utilisations (CGU) lors de la connexion au portail SNDS
- Traitement de données du SNDS depuis des postes AP-HP uniquement (et non des postes personnels)
Conformité au référentiel de sécurité du SNDS :
- L’AP-HP n’étant pas conforme au référentiel de sécurité du SNDS, les données doivent être exclusivement traitées sur le portail de la CNAM ou sur la plateforme du Health Data Hub.
- Des travaux sont en cours pour mettre en conformité l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP (EDS) à ce référentiel. Ces travaux doivent aboutir à horizon octobre 2024 pour permettre à l’AP-HP d’héberger des données du SNDS chaînées aux données de l’EDS dans le cadre d’un projet de recherche.
Comment le pôle transfert et innovation (OTT&PI) de la DRCI peut m’accompagner en tant qu’agent de l’AP-HP porteur d’un projet d’innovation technologique ?
Le pôle transfert & innovation est l’office de transfert de technologies de l’AP-HP (OTT&PI). Il est l’interlocuteur unique au sein de l’AP-HP pour l’évaluation et la valorisation des innovations technologiques des personnels soignants, techniques et administratifs. C’est le point de contact institutionnel identifié pour les sujets relatifs à l’innovation technologique, la valorisation et au transfert de technologies.
Appelé « Technology Transfer Office » (TTO) chez ses homologues étrangers, le pôle transfert & innovation s’organise autour de 5 missions principales :
- Détection des innovations des personnels de l’AP-HP par une équipe dédiée qui intervient au plus près des inventeurs, au sein des GHU
- Evaluation scientifique, technique et économique des innovations technologiques
- Protection et gestion stratégique d’un portefeuille de propriété intellectuelle (brevets, savoir-faire, logiciels, etc.)
- Prospection et négociation de contrats de licence d’exploitation auprès d’entreprises
- Accompagnement des personnels AP-HP à la création d’entreprises qui valorisent leurs travaux de recherche
Grandes étapes du processus de valorisation et calendrier associé :

Et concrètement ?
La devise du pôle c’est « Inventez, valorisez et soignez avec l’AP-HP » avec la gestion aujourd’hui déjà d’un portefeuille de plus de 748 brevets, plus de 200 licences actives et près de 85 start-up crées.
Qu'est-ce qu'un brevet?
Le brevet est un titre qui confère au titulaire :
- un droit exclusif d’exploitation
- pour un territoire déterminé
- pendant une durée déterminée
- sur une invention
- en contrepartie d’une divulgation de l’invention
Qu'est-ce qui est brevetable ?
Critères de brevetabilité :

Je souhaite monter un dossier de concours scientifique conformément à la loi PACTE : quel est l’accompagnement dont je bénéficie ?
Le pôle transfert & innovation de la DRCI sera votre interlocuteur. Il saisira le Collège de Déontologie et vous accompagner selon les grandes étapes suivantes :

En tant que porteur d’un projet d’innovation technologique à quel moment puis-je contacter l’équipe Sourcing présente sur mon site ?
Présents sur chacun des GHU, les chargés de mission sourcing ont pour vocation d’être au plus près des porteurs de projets. En maillant le réseau innovation de votre site, ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour vous orienter au sein de la DRCI en fonction de vos besoins, de vos projets.
Quand contacter le chargé de mission sourcing de votre GHU ?
- Au montage d’un projet, pour vous accompagner le plus tôt possible
- A l’obtention de résultats (in vitro, in vivo, chez le patient, prototype, base de données, logiciel…)
- Pour qualifier un savoir-faire
- Avant publication, présentation (orale, poster, …) portant sur des résultats issus de travaux de recherche
- Avant tout contact avec un industriel, un laboratoire académique (collaboration, promotion…), afin de protéger vos idées dès les premières discussions
Le chargé de mission sourcing pourra alors, après avoir échangé avec vous, vous conseiller et vous orienter vers les experts de la DRCI, selon l’état d’avancement de votre projet.

Comment contacter le chargé de mission sourcing de votre GHU ?
- AP-HP. Nord : Anne Lafon, 01 40 27 19 80
- AP-HP. Centre : Fatiha Mavouna, 01 40 27 19 43
- AP-HP. Saclay, AP-HP. Mondor : Ouerdia Oumohand, 01 40 27 19 30
- AP-HP. Mondor, AP-HP. Seine-Saint-Denis : Alice Gautier
- AP-HP. Sorbonne : Aurélie Guimfack, 01 44 84 17 98
J’ai soumis une déclaration d’invention au pôle transfert & innovation : comment sera évaluée celle-ci en vue d’une possible demande de brevet ?
Le Comité d’Engagement du pôle a pour mission d’analyser la déclaration d’invention selon une approche globale (robustesse scientifique/médicale, stratégie de propriété intellectuelle/brevetabiité, positionnement business/transférabilité). Il se réunit tous les mois afin de passer en revue les nouvelles déclarations selon le schéma suivant :

Lauréat d'un appel à projets, comment le budget de mon projet a-t-il été élaboré ?
Par l’URC et vous lors du dépôt à l’AAP : identification et évaluation des coûts
- Investigation
- Coûts de la recherche sur le patient = surcoûts hospitaliers des services participants à la recherche
- Séjours d’hospitalisation et actes de la recherche hors soin (imagerie, analyses biologiques, dispensation pharmacie…)
- Temps des personnels nécessaires à la réalisation des actes pour la recherche en sus du soin : infirmier, kiné, diététicien, psychologue, technicien de laboratoire, médecin…
- Personnels de soutien à l’investigation (TEC, infirmiers de recherche clinique)
- Recueil de données à partir du dossier médical dans cahier d’observation de la recherche, organisation des rdv patients, participation au monitoring, …
- Coûts de la recherche sur le patient = surcoûts hospitaliers des services participants à la recherche
- Promotion
- Personnels : méthodologie, chefferie de projet, vigilance, monitoring, data et biostatistique
- Assurance
- Selon les projets
- Coût pharmaceutiques : fabrication, achat et gestion des produits de santé expérimentaux (personnels, médicaments, dispositifs médicaux, placebo, …) –> devis de l’AGEPS
- Analyse médico économique
- Pharmaco épidémiologiques
- Développement informatique ou intervention DSN
- Déplacement des ARC (monitoring)
- Autres coûts
- Sous traitance : uniquement pour des prestations que l’AP HP n’est pas en mesure de réaliser
- Frais d’impression (ex : consentements), fournitures, petit matériel (ex : sondes de température)
- Frais de publication et de participation à des congrès
- Indemnités des volontaires
- Frais de gestion 10 des charges de personnel
- Financement des services RH, qualité, finances, achats, juridique, collaboration de la DRCI qui concourent à la mise en oeuvre du projet
- Ils ne peuvent pas être réinjectés dans le budget de l’étude
- Le ministère ne finance pas de dépenses d’investissement
- Matériel/logiciel d’un coût unitaire supérieur à 500 €
Après sa sélection à l'AAP, comment les acteurs du projet sont informés de leur budget ?
Le pôle promotion organise une réunion de lancement de tous les projets lauréats dans les semaines suivant leur sélection pour préparer leur mise en œuvre
- Partage du projet et de son budget avec tous les intervenants :
- Investigateur coordonnateur et responsable scientifique
- URC
- Pôle promotion et vigilance
- Secteurs finances et achat
- Secteur collaboration
- AGEPS
- Identification des étapes, des services pilotes, des livrables, du calendrier, des coûts et des risques
- Validation du budget définitif
- Par type de coût personnel, médicaux et autres
- Par étape du projet
Quand et comment est versé le financement du projet ?
Projets financés par le ministère de la santé
- 5 tranches versées lors de l’atteinte de jalons (PHRC)
- 1ère tranche à la sélection du projet à l’AAP 15 plafonné à 50 k€
- 2ème tranche à l’obtention de la dernière autorisation 25 solde de la 1 ère tranche
- CPP, Clinical trial, ANSM, CNIL
- 3ème tranche à 50 des inclusions 35
- 4ème tranche à la fin du suivi de tous les patients inclus 15
- 5ème tranche à la soumission d’un article à une revue scientifique 10
- A l’atteinte de chaque jalon, le pôle promotion transmet la demande de tranche au ministère avec les pièces justificatives élaborées avec l’URC
- Le ministère instruit la demande, peut demander des compléments d’information : délai++
- Avances de la DRCI
- Après l’atteinte du jalon et pendant le délai de versement de la tranche par le ministère
- Avant l’atteinte du jalon, si les tranches précédentes ont été dépensées et que vous avez des besoins pour faire avancer le projet, la DRCI avance si la promotion estime que le jalon sera atteint dans les 12 mois
Projets financés par l’AP HP (AAP CRC)
- CRC 2 tranches de 50
- 1ère tranche à l’obtention des autorisations 50
- 2nde tranche à la moitié des inclusions 50
Quelle est la durée de disponibilité de financement ?
- Projets ministériels les crédits sont disponibles jusqu’à la fin de l’année suivant le versement de la 5 ème tranche par le ministère
- CRC les crédits sont disponibles 2 ans après l’obtention des autorisations (un des critères d’éligibilité des CRC est que le projet doit pouvoir être mené dans les 2 ans)
- A noter
- La durée règlementaire ( assurance) d’un projet de recherche RIPH du 1 er patient inclus à la dernière visite du dernier patient inclus
- Pour la partie budgétaire, la durée du projet s’entend dès l’instruction du projet de recherche jusqu’à sa publication (principe de la première et de la dernière tranche
- La DRCI attribue une prime d’intéressement de 2 000 aux centres de l’AP HP ayant inclus le nombre de patients prévus pendant la durée d’inclusion (sans prolongation).
Comment puis-je acheter les fournitures, matériels et prestations nécessaires pour mener mon projet ?
Pour tous les achats, contactez le chef de projet de l’URC
- En fonction des cas, il fera le lien avec la DRI du GHU ou avec la DRCI pour contractualiser avec le fournisseur/prestataire si besoin, et commander
- Les achats supérieurs à 40 000 HT sont soumis à des procédures de publication et de mise en concurrence (marchés publics) ce besoin est généralement identifié lors de la réunion de lancement et le délai prévu dans le calendrier du projet
- Si l’AP HP a déjà un marché pour ce produit ou cette prestation : pas de délai.
- Si la DRCI doit élaborer un marché avec la structure ACHAT de l’AP HP, la procédure peut prendre 8 à 12 mois.
Qui suit l'exécution du budget de mon projet et me le transmet ?
L’URC en lien avec le service finance de la DRCI
- L’URC valide et suit les dépenses du projet en fonction du budget
- Elle prépare les éléments pour la demande des recettes ( au ministère
- En cas d’imprévu, de dépenses supplémentaires, elle modifie le budget en lien avec vous en ajustant les différents postes du budget
- Elle vous transmet le suivi budgétaire à la fréquence définie avec vous ou à la demande
Comment sont remboursés les centres de l’AP-HP qui participent à une étude clinique promue par l’AP-HP ?
Lorsqu’un centre de l’AP-HP inclut des patients dans une étude promue par l’AP-HP, il doit être remboursé des frais engagés comme convenu dans le budget prévisionnel de l’étude. Le montant total dépend en général du nombre de patients inclus.
Il existe une procédure qui permet d’enregistrer les contributions respectives de chaque centre pour les inclusions sur chaque projet : les inclusions de patients d’un centre pour un autre donneront lieu à des possibilités de dépenses sous forme de « droits de tirage », permettant d’imputer des dépenses de personnel ou d’exploitation. Ces « droits de tirage » financiers ne peuvent pas être dépensés en investissement. L’outil, un fichier excel partagé, est accessible à tout personnel de l’AP-HP qui en fait la demande auprès de son URC ou du pôle finances de la DRCI.
Quels personnels vont mettre en œuvre mon projet et comment puis-je recruter ou financer du personnel d'investigation ?
- Personnels de la promotion
- La DRCI ( URC et AGEPS) dispose des personnels qui mettront en œuvre votre projet méthodologiste chef de projet, ARC, data manager, biostatisticien, pharmacien, etc et impute leurs coûts sur le financement du projet
- Personnels d’investigation
- Centres coordonnateurs votre contact est l’URC qui gère le projet
- Recrutement ou financement d’un personnel du service.
- Besoin que l’on vous mette un personnel à disposition.
- Centres associés leur contact est la DRI de leur GHU
- L’URC ou l’investigateur coordonnateur transmet aux investigateurs le montant des financements en fonction du nombre d’inclusions (droits de tirage) périodicité variable en fonction des URC, en cours d’harmonisation
- Recrutement ou financement d’un personnel du service.
- Centres hors AP HP la DRCI conventionne avec l’hôpital participant pour lui payer les coûts d’investigation en fonction du nombre de patients inclus (grille de surcoûts annexée à la convention).
- Centres coordonnateurs votre contact est l’URC qui gère le projet
Puis-je payer des heures supplémentaires à du personnel médical ou paramédical sur le financement du projet ?
- Oui mais dans le respect de la règlementation du travail et du budget du projet votre contact est l’URC qui pilote la procédure en lien avec la DRH ou la DAM du GHU
- Validation par la DRH/DAM car tous les statuts/contrats des personnels hospitaliers (paramédicaux, techniques et administratifs) ne permettent de rémunérer des heures supplémentaires
- Levier 25 il est prévu de permettre à certaines professionnels d’appui à la recherche de réaliser des heures supplémentaires rémunérées L’actions sera mise en place au premier semestre 2024
- Accord du responsable du personnel (chef de service/cadre) en fonction de l’organisation et des nécessités du service
- Sans ces accords, nous ne pouvons pas nous engager à payer des heures supplémentaires à des personnels dans le cadre de la réalisation d’un projet de recherche
- Validation par la DRH/DAM car tous les statuts/contrats des personnels hospitaliers (paramédicaux, techniques et administratifs) ne permettent de rémunérer des heures supplémentaires
Comment est utilisé l'intéressement recherche à l'AP-HP ?
Intéressement recherche
Pour appuyer le déploiement des activités de recherche dans la durée sur tous les sites de l’AP-HP, le dispositif d’intéressement recherche a été doublé en 2023 pour passer de 10,3 millions d’euros à 20,6 millions d’euros.
A partir de 2024, l’évolution de l’intéressement recherche est assis sur la progression de la dotation socle reçue par l’AP-HP : 50% de la dotation socle abondera l’intéressement.
En cas de baisse de la dotation socle, l’intéressement recherche diminuera si, et seulement si, cette baisse est liée à une diminution des scores d’activité recherche (et pas à une baisse des financements nationaux).
Ce soutien additionnel à la recherche s’appuiera sur les trois niveaux de gouvernance de l’institution (CHU, GHU et DMU) avec une plus forte proportion accordée aux DMU (50% de l’abondement) pour recentrer les moyens concrets d’action au plus près des investigateurs et des porteurs de projets.
L’utilisation de l’intéressement recherche est recentrée sur deux objectifs stratégiques prioritaires visant à maximiser l’impact :
- le renforcement de l’aide à l’inclusion avec le recrutement de personnels d’appui à la recherche: pour accélérer les délais de réalisation des études, accroitre l’attractivité des centres AP-HP pour les promoteurs externes ;
- soutien à la production et l’animation scientifique : avec l’aide à la rédaction, mise en forme d’articles, frais de publications, participation à des congrès et frais de déplacements associés, organisation d’évènements scientifiques, etc. : pour publier les résultats et gagner en visibilité.
Ses modalités d’utilisation sont souples :
- La notification est faite dès le mois de novembre de l’année N-1 aux GHU avec une notification officielle début février année N.
- Il est possible de dépenser l’intéressement recherche sur plusieurs années avec un suivi trimestriel de dépenses des différentes enveloppes afin de monitorer le niveau de consommation et d’identifier les éventuels freins à l’utilisation.
- Il est possible de réaliser des dépenses d’investissements et de recrutement du personnel d’appui à la recherche.
Projets à promotion industrielle : comment financer du temps personnel ?
Projets à promotion industrielle : mise à disposition du financement du temps personnel aux équipes
Depuis le 4 janvier 2021, un nouveau dispositif de fléchage interne en « RAF IFI » d’une partie des sommes perçues dans le cadre des recherches à promotion industrielle.
Les forfaits ou temps de personnel des professionnels impliqués dans la conduite de la recherche (temps médical, paramédical et pharmacien) sont désormais fléchés en RAF IFI mises à disposition des équipes. Auparavant, ces recettes étaient affectées au budget général de l’hôpital.
Ces moyens désormais fléchés en RAF IFI sont dédiés à l’accompagnement des équipes impliquées dans la recherche partenariale notamment par le renforcement professionnels d’aide à l’inclusion.
Depuis 2021 :
- augmentation des financements de la recherche industrielle qui reviennent aux services ;
- modification de la procédure de fléchage des recettes des projets à promotion industrielle de toutes les conventions uniques signées à partir de janvier2021 sans rétroactivité ;
- mise à disposition des services du financement du temps des personnels (médical, paramédical, laboratoires et pharmacies) participants aux projets industriels : recrutement hors TPER et achats de fonctionnement ou d’investissement.
Sur les 27,7 millions d’euros facturés par les GHU en 2022, la part qui revient aux équipes (coûts et contreparties) est ainsi passée de 60% des montants facturés (16,5 M€) alors qu’elle était de 54% en 2021 et 46% en 2020.
Bon à savoir : le point de contact est la direction recherche et innovation de votre GHU.

Comment réaliser un projet de recherche ou thèse dans un laboratoire partenaire de l'AP-HP ?
L’AP-HP s’allie à divers partenaires du monde universitaire et de la recherche publique pour permettre à des personnels médicaux hospitaliers d’être accueillis au sein d’un laboratoire dans le but de réaliser un projet de recherche.
Cet appel à candidatures, interne et non thématisé scientifiquement, permet à un professionnel médical de l’AP-HP (CCA, AHU, PH, PC) d’effectuer pendant un à trois ans une activité de recherche (notamment une thèse) au sein d’un laboratoire rattaché à l’un des 14 partenaires du dispositif «poste d’accueil».
L’accueil peut se dérouler au sein de laboratoires rattachés aux institutions suivantes : AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, CEA, CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, ESPCI Paris, INRIA, Institut Mines-Télécom, Institut Pasteur, Sorbonne Université (via l’Institut d’Ingénierie en Santé (IUIS), l’Institut des Sciences du Calcul et des Données (ISCD) et Sorbonne Center for Intelligence Artificial (SCAI)),Université Sorbonne Paris Nord, Université de Technologie de Compiègne, Université Paris Cité et l’Université Paris-Saclay.
Ce dispositif contribue au transfert bidirectionnel de connaissances entre les équipes et à la création de synergies.
Il constitue souvent l’amorce de relations partenariales qui se poursuivent entre les équipes par un enrichissement réciproque.
Votre contact à la DRCI : 01 44 84 17 69, marie-agnes.lefevre@aphp.fr

Comment être accompagné sur le montage de mon projet européen ?
L’AP-HP a lancé un nouveau dispositif destiné à soutenir les porteurs de projets européens en coordination : « Temps dédié montage de projets ». Il s’agit d’un dispositif agile, personnalisé et adapté au calendrier des appels à projets pour permettre aux porteurs de projets de libérer du temps pour leur candidature aux appels à projets européens d’envergure (Horizon Europe, IHI, Mission Cancer, etc.).
Le dispositif vise à :
- financer les services concernés, à hauteur de 30 000 €, en contrepartie du temps passé par les porteurs de projets pour préparer leur candidature. L’utilisation de l’aide par le service est libre (sous réserve d’effectivement libérer du temps au porteur du projet) ;
- aider directement le porteur de projet dans le montage du dossier, à hauteur de 10 000 €, en finançant la traduction, la relecture du projet, ou l’organisation de réunions, selon les besoins.
Votre contact à la DRCI : le secteur Europe, affaires-européennes.drc@aphp.fr

Comment réaliser un doctorat en recherche paramédicale ou maïeutique à l'AP-HP ?
La recherche paramédicale contribue à faire progresser la qualité des soins et la prise en charge des patients par l’amélioration des pratiques. Depuis 2010, plus de 360 projets de recherche/lettres d’intention ont été déposés, ce qui représente 25 à 30% des lettres d’intentions déposées au niveau national.
Le dispositif « Doctorat en recherche paramédicale et maïeutique » permet à tous les paramédicaux et sages-femmes de l’AP-HP titulaires d’un master 2 de l’AP-HP de réaliser une thèse de doctorat, pendant 1 an, reconductible (2 ans sous condition d’une audition annuelle avec présentation de l’état d’avancement du projet), à temps plein.
L’AP-HP assure une contrepartie financière afin de pourvoir au remplacement du lauréat et prend en charge les frais d’inscriptions à l’Université et un budget spécifique d’aide au projet de recherche d’un montant maximal de 7 000€.
Le choix du doctorat est libre mais devra être en lien avec le domaine de la santé et en adéquation avec le projet professionnel du candidat et s’inscrire :
- Pour les auxiliaires médicaux, dans la thématique recherche en santé,
- Pour les sages-femmes, dans la thématique périnatalité et santé de la femme et des enfants.
Votre contact à la DRCI : 01 44 84 17 69, marie-agnes.lefevre@aphp.fr

Comment valoriser le temps dédié à la réponse à un appel à projets en recherche en soin ?
La Fondation de l’AP-HP créée en 2015 intervient dans la gestion de financements issus de la générosité des donateurs et de prestations d’expertise, elle a pour objectif de soutenir la recherche et le soin.
Depuis 2017, le dispositif « Passeport Temps Recherche » permet à tous les personnels paramédicaux de l’AP-HP concernés par le dépôt d’un projet dans le cadre d’appels à projets dédiés de valoriser et encourager leur implication dans la recherche paramédicale. Il permet notamment de valoriser les heures consacrées aux réponses aux appels à projets par des professionnels paramédicaux.
Le dispositif vise à :
- Favoriser le développement et la réussite des projets de recherche paramédicale ;
- Prendre en compte le temps de travail consacré par les personnels à l’élaboration de ces projets ;
- Faire progresser la qualité des soins offerts aux patients par l’amélioration des pratiques.
Tous les personnels de l’AP-HP souhaitant déposer un projet de recherche au titre du PHRIP, PREPS, APRESO du GIRCI Ile-de-France ou ANR sont éligibles. Le montant des bourses varie de 300 € pour la réalisation d’une lettre d’intention, à 500 € pour un projet déposé dans le cadre de l’AAP APRESO et à 1 000 € pour un projet dont la lettre d’intention a été retenue et qui est déposé lors de la dernière phase de soumission à l’AAP.
Bon à savoir : Retrouvez l’ensemble des informations sur le site web de la Fondation de l’AP-HP

Comment réaliser une mobilité recherche en Europe ?
Dans le cadre de l’Alliance Européenne des Hôpitaux Universitaires (EUHA), regroupant CHU européens l’AP-HP a lancé en 2023 la 1ère édition du programme d’échange à destination des jeunes cliniciens chercheurs de l’Alliance.
L’ambition de ce programme est de permettre au lauréat de réaliser, durant une période maximale de six mois, une activité de recherche clinique dans l’un des établissements d’accueil de l’Alliance (Allemagne, Autriche, Belgique Danemark et Suède ). A plus long terme, l’objectif de ce dispositif est de renforcer les coopérations de recherche entre les partenaires de EUHA.
Le programme permet au lauréat de réaliser, durant une période maximale de six mois, une activité de recherche clinique dans l’un des établissements d’accueil de l’Alliance.
Durant cette période de mobilité, le salaire hospitalier du lauréat sera maintenu. Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des médecins âgés de 45 ans ou moins, de toutes spécialités confondues, désireux de participer à un projet de recherche clinique au sein d’une institution membre de l’Alliance européenne receveuse : de premier plan dont l’excellence a été démontrée dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la recherche.
- AARHUS, Aarhus Universitetshospital, Danemark ;
- BERLIN, La Charité, Allemagne ;
- LEUVEN, UZ Leuven, Belgique ;
- STOCKHOLM, Karolinska University Hospital, Suède ;
- VIENNE, Medizinische Universität Wien / Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Autriche.
Votre contact à la DRCI : Catherine Tostain-Desmares, 01 44 84 17 83, catherine.tostain-desmares@aphp.fr

Comment développer des plateformes de recherche et d'innovation à l'AP-HP ?
Appel à projets Carnot@AP-HP de soutien aux plateformes technologiques de l’AP-HP
L’appel à projets vise à accompagner le développement et/ou la structuration des plateformes de recherche ou d’innovation de l’AP-HP afin de favoriser l’émergence de nouveaux partenariats public-privé, autour de thématiques de recherche et d’innovation en santé requérant une expertise scientifique ou technologique spécifique ou émergente.
L’appel est ouvert à l’ensemble des professionnels de l’AP-HP contribuant à la recherche clinique.
Les responsables de la plateforme, doivent être employés par l’AP-HP et rattachés à une structure existante de l’AP-HP (DMU, plateformes existantes, services cliniques, pharmacies, laboratoires etc.).
L’organisation fonctionnelle de la plateforme peut être multisite.
L’appel vise à soutenir :
- des projets correspondants à la montée en puissance d’une plateforme existante (renforcement de l’offre de service et de sa visibilité ; acquisition ou développement d’équipements ou de technologies visant à favoriser la réalisation de projets de recherche ; développement de nouvelles expertises) ;
- la création d’une plateforme répondant à un besoin non couvert par des plateformes déjà existantes.
Votre contact à la DRCI : Le Carnot@AP-HP, aapcarnot.sap@aphp.fr

Comment financer un projet de recherche clinique et d'évaluation micro-économique promu par l'AP-HP ?
Contrat de recherche clinique (CRC)
Le Contrat de Recherche Clinique (CRC) 2023 permet de financer des projets de recherche clinique et d’évaluation médico-économique, proposés par des porteurs de projets salariés de l’AP-HP, qui seront promus par l’AP-HP. L’appel à projets (AAP) est ouvert aux personnels médical et paramédical. Il est dôté de 850 000 €
La CES et la DRCI de l’AP-HP ont retenu deux volets distincts pour le CRC 2023 : un axe libre et un axe concernant l’évaluation de dispositifs médicaux innovants.
Pour favoriser l’émergence de nouveaux chercheurs, un investigateur ayant déjà obtenu un financement dans le cadre d’un PHRC ne peut pas déposer un projet dans le cadre du CRC 2023 et le coordonnateur devra avoir soutenu sa thèse (de médecine, d’odontologie ou de pharmacie) ou obtenu son diplôme professionnel (par exemple diplôme d’état d’infirmier) depuis moins de 10 ans.
Chaque projet soumis sera évalué par 2 rapporteurs de la CES. Les projets ainsi évalués seront ensuite analysés et sélectionnés en séance plénière par la CES. Les projets seront interclassés et retenus en fonction de leur rang de classement et de l’enveloppe budgétaire disponible.
Vos contacts à la DRCI : votre URC
- CRC axe libre : caroline.fisch@aphp.fr et aap.crc.drc@aphp.fr
- CRC axe innovation : julien.matricon@aphp.fr et cellule.innovation@aphp.fr
Comment financer un projet prématuré de recherche innovant ?
Fonds Carnot@AP-HP de prématuration de projets
La DRCI a complété son offre de soutien à la recherche et à l’innovation avec le Fonds Carnot@AP-HP de pré-maturation. Pour accompagner et confirmer le potentiel naissant de projets innovants prometteurs, ce nouveau dispositif de financement alimenté par l’abondement Carnot est doté de 200 000 €. Cet appel a été lancé pour la première fois en 2022, année pilote.
Ce dispositif permet d’accompagner des projets plus en amont avec un niveau de maturité technologique 3 (TRL, Technology Readiness Level) ou un niveau de preuve de concept. Il s’agit donc d’amorcer des projets ne répondant ni aux critères des appels à projets de recherche fondamentale ni aux appels à projets pré-existants de la DRCI. Les projets qui auront reçu un financement de ce dispositif de pré-maturation doivent pouvoir, en fonction des résultats obtenus, répondre à des appels à projets de plus grande envergure, générer de la propriété intellectuelle ou encore aboutir à une collaboration de recherche avec un partenaire industriel.
Cet appel est ouvert à tout le personnel de l’AP-HP quel que soit son corps de métier (personnel médical, paramédical, technique, administratif,…). Toute personne ayant un projet de recherche et/ou de développement (logiciel, algorithme, prototypage basse fidélité) peut se rapprocher du chargé mission sourcing de technologies de son GHU de rattachement.
Vos contacts à la DRCI :
- AP-HP. Nord : Anne Lafon, 01 40 27 19 80
- AP-HP. Centre : Fatiha Mavouna, 01 40 27 19 43
- AP-HP. Saclay, AP-HP. Mondor : Ouerdia Oumohand, 01 40 27 19 30
- AP-HP. Mondor, AP-HP. Seine-Saint-Denis : Alice Gautier
- AP-HP. Sorbonne : Gisèle Digni-Hellier, 01 40 27 58 85
Comment valoriser mon invention à l'AP-HP ?
Booster innovation
L’appel à projets intitulé « Booster Innovation » est co-évalué par la commission d’expertise scientifique (CES) de l’AP-HP et les pôles de compétitivité franciliens (Medicen Paris Région, Cap Digital et Systematic). Il vise à financer la maturation des projets mettant en œuvre des technologies développées par les équipes de l’AP-HP et ayant un potentiel de transfert industriel rapide.
L’objectif poursuivi par cet AAP est d’apporter une aide aux thérapeutiques de demain et aux technologies innovantes développées au sein de l’AP-HP pour à terme mieux soigner les patients. Les critères d’éligibilité des projets sont les suivants :
- avoir bénéficié d’une première évaluation positive du potentiel de valorisation par le pôle transfert et innovation de la DRCI ;
- avoir fait l’objet d’une protection (brevet, logiciel ou savoir-faire) ; ou protection en cours par le pôle transfert & innovation de la DRCI ;
- avoir fait la preuve analytique ou expérimentale du principe ou du concept ;
- avoir identifié un ou des partenaires industriels susceptibles de commercialiser la technologie.
Les financements alloués pour chaque projet retenu seront de 100 000 € au maximum (50 000 € maximum pour les projets logiciels et base de données). Les actions financées par le Booster Innovation couvrent :
- le prototypage ;
- les prestations de service ;
- la validation de méthodes sur collections biologiques.
Attention, les essais cliniques sont exclus du périmètre de financement du fonds Booster innovation.

Que faire lors de l'annonce d'une inspection d'un centre investigateur ?
Vous venez d’être informé d’une prochaine inspection de votre service dans le cadre d’une recherche par une autorité compétente (ANSM, EMA, FDA), voici les actions à mener dans les meilleurs délais :
- Accuser réception de la notification à l’autorité compétente. Il est possible de demander un report raisonnable de la date de visite d’inspection, en le justifiant.
- Informer le promoteur. Vous serez accompagné dans la préparation de cette inspection. Un monitoring du service et de la PUI pourra être réalisé.
- Informer la direction de la recherche et de l’innovation de votre GHU et la DRCI de l’AP-HP à l’adresse suivante : drc-equipe-qualite@aphp.fr. Cette dernière se chargera de demander les accès à ORBIS pour les inspecteurs et vous conseillera sur la préparation de cette inspection.
- Prévoir, le cas échéant, un traducteur pour faciliter les échanges avec les inspecteurs (en anglais).
- Informer toutes les personnes concernées de votre équipe de l’inspection (co-investigateurs, PUI, etc.). Il est indispensable de se préparer collectivement au déroulement de l’inspection : contrôle des dossiers sources et documents de la recherche, mise en conformité. Faire des points de suivi réguliers jusqu’à la date de l’inspection. (Cf. question suivante)
- Organiser la logistique de l’inspection
- Réserver une salle pour accueillir les inspecteurs sur toute la durée de l’inspection
- Mettre à disposition un ordinateur par inspecteur, et prévoir des droits d’accès temporaires aux sessions pour les inspecteurs, en lien avec le service informatique de l’établissement.
- Prévoir une photocopieuse accessible aux inspecteurs.
- Donner accès au dossier patient informatisé et applications utiles aux inspecteurs. Le responsable du service inspecté doit transmettre à la DRCI (drc-equipe-qualite@aphp.fr), les éléments suivants, afin que la DSN ouvre les droits aux inspecteurs sur le DPI en lecture seule :
- Les dates de visites prévues
- Le nom et l’adresse e-mail des inspecteurs
- Les numéros des UF du ou des services
- Les applications devant être accessibles aux inspecteurs (DPI ORBIS/DXCARE, autres applications comme l’imagerie, etc.).
Comment se préparer à une inspection ?
Vous venez d’être informé d’une prochaine inspection de votre service dans le cadre d’une recherche par une autorité compétente (ANSM, EMA, FDA), plusieurs éléments essentiels doivent impérativement être vérifiés avant la visite d’inspection :
- Les consentements des participants
- Le formulaire de délégation des tâches (service et PUI)
- La déclaration des EIG
- Les documents essentiels de la recherche du classeur investigateur, tels que le protocole, les amendements, les formulaires de consentements des patients, la brochure de l’investigateur, les notifications d’EIG, etc.
- Pour chaque intervenant, la traçabilité de la formation à la recherche clinique (attestation BPC, CV) et de la formation à l’étude
Il est recommandé de préparer une présentation du service et de son activité de recherche clinique (nombre d’études cliniques en cours, organigramme, nombre de personnes affectées à la recherche, etc.).
Le pôle transformation et management de la qualité de la DRCI pourra vous accompagner dans la préparation de cette inspection. Contact : drc-equipe-qualite@aphp.fr
Comment se déroule une inspection ?
Une inspection par une autorité compétente (ANSM, EMA, FDA) se déroule en 4 temps
Phase de pré-inspection
Le responsable de l’autorité compétente
- envoie une notification de l’inspection au responsable du service inspecté avec la date prévisionnelle de visite
par courrier ou mail, au maximum 30 jours avant la date de la visite
> Il est possible de demander un report raisonnable de la date de visite d’inspection, en le justifiant.
Le responsable de la structure inspectée
- accuse réception de la notification et informe :
- le promoteur de l’étude,
- sa Direction de la Recherche et de l’Innovation du GHU,
- ainsi que la DRCI.
L’investigateur principal du centre inspecté
- prépare l’inspection en collaboration avec le personnel concerné. (Voir le chapitre : Quoi faire en cas d’annonce d’une inspection d’un centre d’investigation ?).
Phase d’inspection du site
La durée de l’inspection est de 2 à 3 jours sur site, en moyenne.
- La visite débute par une réunion d’ouverture, où sont conviés :
- l’ensemble des intervenants sur la recherche (y compris la PUI),
- la direction de la recherche et de l’innovation du GHU,
- et un représentant du promoteur, si souhaité par le responsable du service inspecté.
> Les inspecteurs rappellent au personnel concerné le programme et les objectifs de l’inspection.
> Le responsable du service inspecté présente alors son activité de recherche.
- Déroulement de la visite
- Visite des locaux (pas systématique),
- Entretien des inspecteurs avec le personnel du centre impliqué sur la recherche sur les activités et le fonctionnement de leur secteur,
- Analyse par les inspecteurs (en fonction de la nature de l’inspection), logiciel, classeur investigateur, dossiers médicaux, système documentaire, etc.
- Réunion de clôture
> Les inspecteurs énoncent et discutent avec l’investigateur principal du site et les personnels inspectés des principales observations relevées lors de l’inspection. Il est à noter que les observations faites ne seront alors pas cotées (selon leur criticité).
Phase post-inspection
L’investigateur principal organise, une réunion avec l’ensemble du personnel pour les remercier de leur implication. L’équipe met en place sans attendre les mesures correctives suite aux écarts relevés par les inspecteurs.
> Dans la semaine qui suit la fin de l’inspection
L’autorité compétente transmet, au responsable du service inspecté, le rapport préliminaire d’inspection, avec la liste de l’ensemble des observations relevées lors de l’inspection.
> Dans un délai de 60 jours environ
L’investigateur principal
- informe le promoteur, la direction de la recherche et de l’innovation et la DRCI du pré-rapport,
- transmet une liste des actions correctives décidées pour répondre aux observations relevées lors de l’inspection en répondant point par point aux différents écarts. Il est important de préciser un planning de mise en place précis pour chaque action.
> dans un délai de 15 jours
Rapport final de l’inspection
Au regard des réponses apportées, les inspecteurs élaborent et transmettent le rapport final d’inspection au responsable du site inspecté.
Dans ce dernier, les écarts sont maintenus ou réévalués. Le rapport final clôt la procédure contradictoire.
> dans les 45 jours (environ)
L’investigateur principal informe le promoteur, la direction de la recherche et de l’innovation et la DRCI du pré-rapport.
Quelles sont les mesures prises par l'ANSM à la suite d'une inspection ?
A l’issue de l’inspection, l’ANSM transmet un rapport final d’inspection qui détaille les écarts et/ou remarques constatés lors de l’inspection, y compris dans les cas où une action corrective a déjà été prise ou est envisagée.
Les écarts observés par rapport à un référentiel opposable seront classés comme suit : (Sources ANSM)
- Ecart mineur: Les observations classées comme mineures indiquent le besoin d’amélioration des conditions, pratiques et processus
- Ecart majeur: Les données peuvent être refusées et des sanctions administratives ou des poursuites pénales peuvent être engagées
- Ecart critique: Les données sont refusées et des sanctions administratives ou des poursuites pénales sont engagées
- Remarques : Observation qui ne peut-être caractérisée par un référentiel opposable
- Demandes de clarification
La direction générale de l’ANSM peut prendre une décision d’injonction exigeant de la personne intéressée de régulariser la situation dans un délai qu’elle détermine. Cette injonction intervient après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations. L’injonction est publiée sur le site internet de l’agence jusqu’à ce que la situation ait été régularisée.
Puis-je donner accès au dossier patient informatisé à un ARC moniteur, un auditeur ou inspecteur ?
Oui.
Dans le cadre d’une recherche clinique (recherche impliquant la personne humaine, RIPH) à laquelle des patients ont participé, l’investigateur doit permettre aux personnes dûment mandatées par le promoteur de la recherche, son suivi, le contrôle de sa qualité et son audit. C’est pourquoi l’investigateur autorise les représentants habilités du promoteur à avoir un accès direct, en lecture seule, aux données électroniques des patients se prêtant à la recherche.
Pour connaitre les règles d’accès au dossier patient informatisé ORBIS par les ARC moniteurs dans le cadre des recherches cliniques, prenez connaissance de la note destinée aux promoteurs industriels et académiques.
En interne, comment faire des demandes d’accès au DPI pour les ARC moniteur ?
Le demande d’accès au DPI (ORBIS ou Dxc@re) pour un ARC moniteur est réalisée par le N+1, l’investigateur ou cadre du service, fait une demande dématérialisée via l’outil SMAX disponible sur l’intranet ou l’outil mis en œuvre par le GHU.
Après que la personne concernée s’est engagée à respecter le règlement intérieur et a signé la charte d’utilisation du DPI, le N+1, l’investigateur ou cadre du service ou cadre d’URC, fait une demande dématérialisée via l’outil SMAX disponible sur l’intranet (offre SIP_ORBIS_HABILITATIONS) ou l’outil mis en œuvre par le GHU (cf. Annexe ci-dessous) d’ouverture de droit sur ORBIS selon le profil « 0_REC_PROMOTION »
L’ouverture initiale des accès est réalisée par les directions informatiques locales (DSIL) des GHU qui créent un compte utilisateur spécifique pour la personne concernée afin qu’elle puisse se connecter à ORBIS. L’ouverture de ce compte et l’attribution des droits sur Orbis se fait pour une durée limitée aux besoins de la mission.
En cas de demande d’accès multi-GHU, pour un utilisateur qui a déjà des accès sur son site, la demande est à transmettre à l’adresse suivante dsi-csa-habilitations-dossier-patient@aphp.fr
Important : Pour limiter l’accès des ARC moniteur aux patients inclus dans l’étude, le service doit impérativement rattacher les patients au protocole concerné. Pour ce faire, ils peuvent consulter les tutoriels “ORBIS et moi” disponibles via le lien suivant : https://www.formaphp.fr/course/view.php?id=1172
Annexe contact SI-ORBIS :
Vous trouverez ci-après, les contacts DSIL regroupés au niveau des GHU :
- GHU Paris-Seine-Saint-Denis : habilitations.hupssd.avc@aphp.fr ou SMAX
- GHU Sorbonne Université : SMAX
- GHU Nord – Université de Paris : Outil intranet local
- GHU Paris Saclay : SMAX
- Pour le GHU HMN : SMAX
- GHU Centre – Université de Paris : SMAX
- Pour le site HND le contact est : hnd-ref-habilitations@aphp.fr ou SMAX
Comment faire des demandes d’accès ORBIS pour les auditeurs ?
Dans le cas d’une demande de droits pour des auditeurs, et après la signature de la charte d’utilisation ORBIS par ces derniers, le responsable du service audité (ou cadre du service) effectue la demande d’ouverture de droits par le service via SMAX (offre SIP_ORBIS_HABILITATIONS) en spécifiant le profil d’un promoteur, ‘9_AUDITEUR_EVALUATEUR’.
Pour limiter l’accès des inspecteurs aux patients inclus dans l’étude, le service doit impérativement rattacher les patients au protocole concerné. Pour ce faire, ils peuvent consulter les tutoriels “ORBIS et moi” disponibles via le lien suivant : https://www.formaphp.fr/course/view.php?id=1172
Comment faire des demandes d’accès ORBIS pour les inspecteurs des autorités compétentes ?
Dans le cas d’une annonce d’inspection, et afin d’ouvrir les droits aux inspecteurs sur le DPI en lecture seule, transmettre à la DRCI à l’adresse suivante : drc-equipe-qualite@aphp.fr, en mettant en copie la direction de la recherche du GHU, les éléments suivants :
- Service inspecté, nom de l’investigateur principal
- Les dates de visites prévues
- Le nom et l’adresse e-mail des inspecteurs.
- Les numéros des UF du ou des services.
- Les applications devant être accessibles aux inspecteurs, en plus du DPI Orbis (par exemple : imagerie, etc.).
Le pôle transformation et management de la qualité se chargera de demander les accès ORBIS, tandis que la DRI pourra accompagner le service sur des aspects logistiques, entre autres.
Important : Pour limiter l’accès des inspecteurs aux patients inclus dans l’étude, le service doit impérativement rattacher les patients au protocole concerné. Pour ce faire, ils peuvent consulter les tutoriels “ORBIS et moi” disponibles via le lien suivant : https://www.formaphp.fr/course/view.php?id=1172